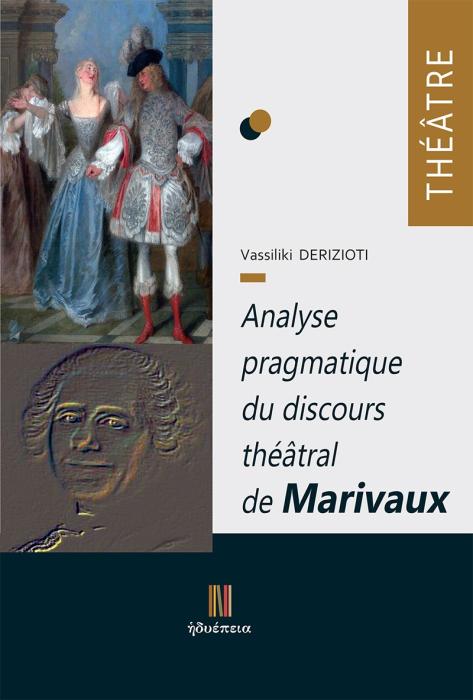Καλέστε μας
2310797405
2310797405
Προιόντα
Περιγραφή
Comme il a déjà été mentionné, l’originalité de ce travail réside dans la théorie linguistique, la pragmatique, que nous avons appliquée sur ce dramaturge privilégié pour son style marivaudien, plein d’inférences. Or, avant de procéder à la révélation de la dimension pragmatique du marivaudage, il vaudrait mieux définir ce que nous entendons par ce terme. Marivaudage et marivauder sont apparus du vivant même de Marivaux, pour indiquer un style particulier, défini par «un mélange le plus bizarre de métaphysique subtile et de locutions triviales, de sentiments alambiques et de dictions populaires». Avec cette valeur, ces mots étaient généralement employés par ses adversaires de la première moitié du XVIII siècle de façon dépréciative, notamment par les puristes, les tenants de la littérature traditionnelle. Pourtant à la deuxième moitié du même siècle, Marivaux «vient à la mode»; le marivaudage devient synonyme de grâce et de tendresse spirituelle. En outre, une autre définition, un peu plus récente, a été proposée par Larousse au début du vingtième siècle, faisant allusion à un style d’afféterie, de galanteries raffinées.
Le marivaudage renvoie à un style précis, qui effectivement n’a rien à voir avec ce «je ne sais quoi» prétendu par certains auteurs. Le long de cette analyse pragmatique de notre corpus, nous nous sommes rendu compte du magistral maniement du langage de la part de Marivaux. Toutes les oeuvres analysées coïncident sur l’usage d’un langage codé qui incite tant les interlocuteurs que les spectateurs à procéder à une opération de déchiffrage. Marivaux montre son goût pour parler «à mots couverts», pour le langage opaque. Les personnages de ses oeuvres disent de l’explicite pour faire passer de l’implicite. Dans notre effort de traquer l’implicite, nous nous sommes aperçu d’un phénomène totalement particulier; les contenus implicites sont éparpillés partout dans ses oeuvres.
…
H πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου έγκειται στη γλωσσολογική και πραγματολογική
Άλλες λεπτομέρειες
- Language:
- ΓΑΛΛΙΚΑ
- DateIssued:
- 2024-02-15
- Περιτύλιγμα Δώρου:
- Διαθέσιμες επιλογές στο καλάθι
- Βάρος:
- 250 g
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Είδατε πρόσφατα
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- GAMING
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PC
-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ
- CARD READERS
- ΔΙΚΤΥΑΚΑ
- ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
- EXTENDERS - REPEATERS - WIFI
- HOME MESH WIFI
- MOUSEPADS
- POWERLINES
- ROUTERS - MODEMS
- SWITCHES
- UPS
- USB HUBS
- WEB CAMERAS
- WIFI BLUETOOTH ADAPTERS
- ΒΑΣΕΙΣ PC/LAPTOP
- ΚΑΛΩΔΙΑ USB
- ΟΘΟΝΕΣ
- ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
- ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ
- ΠΟΝΤΙΚΑ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΘΟΝΩΝ
- ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙΑ
- ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LAPTOP
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
- ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & POWERBANKS
-
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΧΟΜΠΥ
-
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
- ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
- ΓΝΩΣΗ
- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
- ΔΟΚΙΜΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
- ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
- ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ
- ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
- ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
- ΛΕΞΙΚΑ
- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
- ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
- ΔΙΚΑΙΟ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΔΟΚΙΜΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
- ΙΑΤΡΙΚΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
- ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
- ΠΑΙΔΙΚΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ
-
ΣΠΙΤΙ, ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- ΣΠΙΤΙ, ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
- ΒΙΒΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ANTI STRESS)
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
- ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΔΙΑΙΤΑ
- ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
- ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΚΡΑΣΙΑ - ΠΟΤΑ
- ΠΑΙΔΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
- ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΟΜΟΡΦΙΑ
- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ - ΧΑΡΤΕΣ
- ΦΥΣΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
-
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
- ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
- ΑΓΓΛΙΚΑ
- ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ
- ΑΛΒΑΝΙΚΑ
- ΑΡΑΒΙΚΑ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
- ΓΑΛΛΙΚΑ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ
- ΔΑΝΕΖΙΚΑ
- ΕΒΡΑΙΚΑ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΙΑΠΩΝΙΚΑ
- ΙΝΔΙΚΑ
- ΙΣΠΑΝΙΚΑ
- ΙΤΑΛΙΚΑ
- ΚΙΝΕΖΙΚΑ
- ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ
- ΚΟΥΡΔΙΚΑ
- ΚΡΟΑΤΙΚΑ
- ΛΑΤΙΝΙΚΑ
- ΛΕΞΙΚΑ
- ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ
- ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
- ΟΥΓΓΡΙΚΑ
- ΟΥΡΝΤΟΥ (ΙΝΔΙΚΑ)
- ΠΟΛΩΝΙΚΑ
- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
- ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
- ΡΩΣΙΚΑ
- ΣΕΡΒΙΚΑ
- ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ
- ΣΟΥΗΔΙΚΑ
- ΤΟΥΡΚΙΚΑ
- ΤΣΕΧΙΚΑ
-
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ
- ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΠΑΙΔΙΚΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
- ΣΠΙΤΙ, ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ - ΧΑΡΤΕΣ
- ΦΥΣΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΧΟΜΠΥ
- ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ